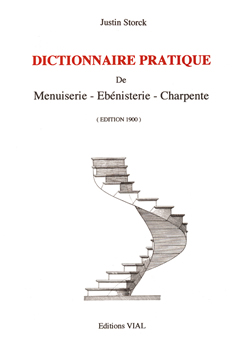Enseigne
subs. fém.
I. Men. Partie d'une devanture placée au-dessus des châssis vitrés, entre l'architrave et la corniche et sur laquelle on indique le nom ou la profession
du commerçant. Cette partie se nomme tableau d'enseigne. Fig. 1358.
On fait également des tableaux d'enseigne qui ne font pas partie adhérente de la devanture. (Voy. devanture.)
Fig. 1359. Tableau d'enseigne Louis XVI.
II. Législ. Pour les enseignes, tableaux enseignes, attributs, écussons, grands tableaux (frises courantes portant enseignes), le décret du 22 juillet 1882 autorise
des saillies sur la voie publique de 0m,16 jusqu'à 2m,60 au-dessus du trottoir ; de 0m,30 et de 2m,60 à 3 mètres au-dessus du trottoir et de 0m,50 et à plus de 3 mètres.
Ces enseignes ne peuvent en aucun cas être suspendues ni appliquées soit aux balcons, soit aux marquises. Sur les garde-corps des balcons peuvent être appliqués des lettres et des attributs dont l'épaisseur ne peut excéder 0m,10 et la hauteur dépasser celle du garde-corps du balcon.
Les enseignes faisant saillie sur la voie publique ne peuvent être établies sans une autorisation de voirie.
Les enseignes en potence ont été supprimées par une ordonnance de police du 17 décembre 1761 et remplacées par des tableaux appliqués contre les murs des boutiques. Cette suppression a été confirmée par une ordonnance du 10 décembre 1784 qui accorde la saillie de 0m,16 sur le nu du mur de face pour étalages et tableaux servant d'enseignes à la condition que ceux-ci seront fixés haut et bas par des crampons de fer scellés dans le plâtre du mur et recouvrant le bord desdits tableaux.
Enfin, une ordonnance du 15 février 1830 réglemente diverses conditions d'appositions d'enseignes pour coiffeurs, perruquiers, teinturiers, écriteaux, etc.
Mise à jour 2019-01-04
Lettres
Ce dictionnaire en version papier