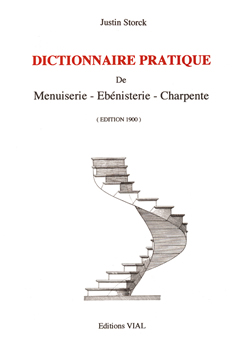Digue
subs. fém.
 Ouvrage en terre ou en maçonnerie destiné à soutenir les eaux élevées par un barrage à une hauteur déterminée, ou à garantir les propriétés voisines contre les inondations.
Ouvrage en terre ou en maçonnerie destiné à soutenir les eaux élevées par un barrage à une hauteur déterminée, ou à garantir les propriétés voisines contre les inondations.
Législ. Aucune digue ne peut être construite dans le lit d'un fleuve ou d'une rivière sans une autorisation administrative préalable. Toute contravention à cette prescription est passible d'amende et entraîne la démolition de l'ouvrage irrégulièrement établi.
Quand il s'agit de digues destinées à défendre les riverains contre les inondations, la loi du 16 septembre 1807 (art. 33 et suivants) donne au gouvernement le droit d'en prescrire la construction après que la nécessité en a été constatée ; ces travaux sont faits aux frais des propriétaires dont les immeubles sont protégés et qui se forment en syndicat ; s'il y a lieu, des subventions peuvent être accordées par l'État, qui participe aussi à la dépense.
D'après l'article 640, Code civil, le fonds inférieur est assujetti, envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement, sans que la main de l'homme y ait contribué; le propriétaire du fonds inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
On distingue les levées, qui sont les digues établies le long des rivières, et les jetées, qui sont construites pour protéger l'entrée des ports.
Notre figure 1291 reproduit d'après Cessart le profil d'une grande jetée en charpente.
Mise à jour 2019-01-04
Lettres
Ce dictionnaire en version papier