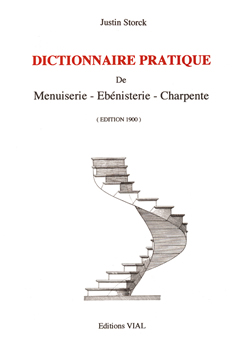Dorique (ordre)
adj.
 Arch. Le deuxième des cinq ordres d'architecture. On distingue le dorique grec et le dorique romain.
Arch. Le deuxième des cinq ordres d'architecture. On distingue le dorique grec et le dorique romain.
Le premier, qui prend aussi le nom d'ordre de Pœstum, est le plus ancien des ordres grecs. Dans cet ordre, la colonne n'a ni base ni astragale, lequel est seulement marqué par plusieurs grains d'orge ; le fût est court et cannelé à vive arête : la diminution est en ligne droite du bas de la colonne jusqu'au dessous du chapiteau, caractérisé par un abaque ou tailloir très saillant supporté par un solide de révolution ou moulure ayant un galbe plus ou moins prononcé que l'on appelle échine. (Voy. ce mot.) L'échine est reliée au fût de la colonne par les annelets ou petits listels au nombre de trois ou cinq, séparés par des cavets.
L'entablement se compose d'une architrave unie, séparée de la frise par un large filet. Cette dernière est ornée de tables saillantes cannelées, appelées triglyphes. (Voy. ce mot.) L'espace rectangulaire qui les sépare prend le nom de métope ; elles sont quelquefois ornées de sculptures. (Voy. métope.) La corniche de l'entablement est d'une grande simplicité.
Fig. 1239. Elévation de l'ordre de Paestum.
L'ordre dorique romain diffère de l'ordre dorique grec par ses formes et ses proportions. Il est beaucoup moins pur de formes que l'ordre dorique grec et a beaucoup moins de caractère que ce dernier.
La colonne, plus élancée, repose sur une base et se termine par un astragale.
Le chapiteau est moins saillant ; il a une échine qui a la forme d'un quart de rond et un tailloir couronné d'une moulure ; l'architrave a moins d'importance et la corniche est plus divisée : le dessous du larmier est orné de denticules ou de mutules. (Voy. ces mots.) Dans le premier cas l'ordre prend le nom de dorique denticulaire et celui de dorique mutullaire dans le second ; ils ne diffèrent entre eux que par les détails de la corniche.
Dans le dorique romain les triglyphes des angles ornant la frise correspondent avec l'axe des colonnes, ce qui n'a pas lieu dans le dorique grec ; la proportion des triglyphes et des métopes en largeur est disposée pour qu'il y ait toujours un triglyphe dansl'axe des colonnes, des entre-colonnements et des portiques ; les mutules et les denticules suivent les axes des triglyphes.
La hauteur de l'ordre dorique romain, du bas du piédestal au sommet de l'entablement, est de 28 modules et 4 parties, dont 5 modules 4 parties pour le piédestal, 16 pour la colonne et 4 pour l'entablement. Fig. 1240.
Le module ou le demi-diamètre de la colonne se divise en douze parties ou minutes, comme pour l'ordre toscan.
Les trois membres principaux de cet ordre se décomposent en hauteur de la manière suivante :
Base du piédestal, 10 parties ou minutes ;
Dé
4 modules ;
Corniche, 6 parties.
pour la colonne
La base est de 4 module ;
Le fût, 14 modules ;
Le chapiteau, 1 module.
entablement
Architrave, 1 module ;
Frise, 1 module 6 parties ;
Corniche, 1 module 6 parties.
La saillie de la corniche sur le nu de la frise, qui est le môme que celui de la partie inférieure de l'architrave et de la partie supérieure du fût de la colonne au-dessous de l'astragale, est de 2 modules.
Le diamètre du fût à cet endroit est de 1 module 8 parties.
La largeur de la base de la colonne et celle du dé du piédestal sont de 2 modules 10 parties.
Mise à jour 2019-01-04
Lettres
Ce dictionnaire en version papier