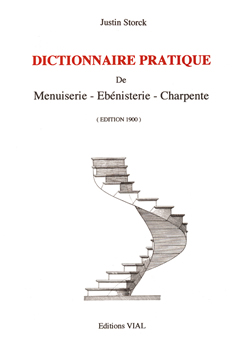Mèche
subs. fém.
 Tige de fer aciéré que l'on fixe à un vilebrequin (voy. ce mot) pour percer des trous dans le bois, la pierre tendre, le métal.
Tige de fer aciéré que l'on fixe à un vilebrequin (voy. ce mot) pour percer des trous dans le bois, la pierre tendre, le métal.
La partie supérieure d'une mèche entre dans une douille pratiquée dans le vilebrequin, où se trouve une vis de pression. Cette partie supérieure a la forme d'une pyramide quadrangulaire tronquée, dont une face porte en général une entaille dans laquelle s'engage la vis du vilebrequin.
La partie inférieure, qui sert à percer et qui est la mèche proprement dite, se fait de différentes formes et de grosseurs différentes suivant l'emploi. On distingue la mèche à cuiller (fig. 2416), qui est cannelée dans sa longueur et dont le bout est relevé ; la mèche anglaise (fig. 2417), qui a un pivot au centre, un dard, et un couteau ou partie tranchante légèrement incliné ; il décrit une circonférence un peu plus faible que celle du dard, afin de ne pas arracher le bois.
Les mèches torses a vis (fig. 2418), dont la partie inférieure rappelle la mèche anglaise, mais dont le dard a la forme d'une vis conique.
Les mèches à vrille (fig. 2419), ainsi nommées parce qu'elles en ont la forme (voy. vrille), ont la pointe en vis conique prolongée par une cannelure longitudinale ou torse.
 Une autre mèche dont la forme découle de la précédente est celle reproduite par la figure 2420, mèche lyonnaise.
Une autre mèche dont la forme découle de la précédente est celle reproduite par la figure 2420, mèche lyonnaise.
Fig. 2421. Mèche américaine à tige centrale.
Fig. 2422. Mèche américaine expansible, perçant de 12 à 38 millimètres : la pièce 7 fr. 50 ; perçant de 22 à 76 millimètres ; la pièce, 12 francs.
Fig. 2423. Mèche de chaisier.
Fig. 2424. Mèche à brique ordinaire ; la pièce, 0 fr. 45.
Fig. 2425. Mèche à brique à ailes ; la pièce, 0 fr. 70.
Fig. 2426. Fraise à bois et à métaux ; la pièce 0 fr. 70.
Fig. 2427. Équarrissoir 16 millimètres ; la pièce, 0 fr. 85.
Enfin, il convient de citer également, pour forer de grands trous, la mèche à trépan, reproduite par la figure 2428.
Mise à jour 2019-01-04
Lettres
Ce dictionnaire en version papier