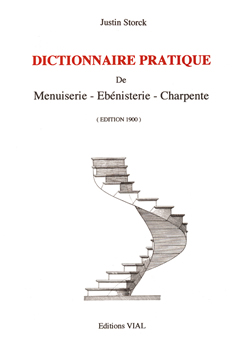Menuisier
subs. masc.
Ouvrier qui exécute des travaux de menuiserie ; l'entrepreneur qui les entreprend et les fait exécuter.
Avant 1789, ils formaient une corporation dont les premiers statuts datent de la fin du XIVe siècle ; ils célébraient la Sainte-Anne le 28 juillet, anniversaire du jour où ces statuts leur avaient été donnés.
D'après Roubo, les menuisiers portaient primitivement le nom de huchers, ou huchiers (fabricants de huches). (Voy. ce mot.) On les nommait aussi lambrisseurs, du mot lambris, et huissiers, du mot huis, qui signifie porte.
C'est un arrêt de la Cour du 4 septembre 1382 qui les a autorisés à prendre le nom de menuisiers, parce qu'ils « amenuisent les bois en les rendant plus menus, plus minces au moyen de la varlope, du rabot et autres outils ».
Ils faisaient partie de la communauté des charpentiers et étaient placés sous l'autorité du premier charpentier du roi.
Ils ont aussi porté le nom de charpentiers de la petite cognée, après leur séparation d'avec les charpentiers qui portaient celui de charpentiers de la grande cognée. (Voy. Charpentier.)
Le nom de bahutier, qui date du XVe siècle, s'appliquait aux menuisiers qui fabriquaient spécialement des meubles, tels que bahuts, crédences, cabinets, coffres, etc. Avec l'emploi des bois exotiques et des bois de roses, tel que l'ébène, qui fut employé l'un des premiers en placage, ils prirent le nom d'ébénistes. (Voy. ébéniste.)
Un menuisier ne doit pas seulement être l'ouvrier sachant travailler le bois ; pas mal d'autres connaissances lui sont nécessaires. Il doit connaître les premières notions de l'arithmétique, de la géométrie descriptive et du dessin linéaire.
C'est là le minimum de ce que doit savoir un menuisier complet. Tout ouvrier travaillant le bois qui ne possédera pas ce minimum de science ne sera jamais qu'un ouvrier fort incomplet, capable seulement des travaux les plus ordinaires. Il est indispensable qu'un menuisier sache bien lire un plan, et même en tracer un ; la géométrie descriptive lui facilitera ce travail.
Ses connaissances en dessin ne doivent pas se limiter à des notions générales, à des essais plus ou moins informes. La connaissance des styles est également indispensable ; car, suivant les époques, la mouluration a différé, et il est nécessaire qu'un menuisier appelé pour raccorder une menuiserie ancienne ou pour en exécuter une nouvelle d'un style déterminé ne soit pas embarrassé et ne soit pas en situation de commettre quelque faute contre les styles.
Cette connaissance des caractères particuliers de chaque style lui sera, du reste, de toute utilité pour mieux interpréter et exécuter les travaux dont les dessins lui auront été remis par l'architecte. Le menuisier doit connaître également les propriétés différentes des bois, leurs qualités, leurs défauts, l'appropriation d'un bois pour tel travail préférablement à un autre bois ; la façon dont le bois se comporte dans le travail, le jeu qu'il faut lui ménager.
Les outils employés par le menuisier sont nombreux, en dehors de l'établi, du rabot, du maillet, du marteau et des tenailles, des trusquins, équerres, règles et compas.
On peut citer les outils à fût, servant à corroyer le bois, comme varlope, rabot, etc., les bouvets, les outils de moulures, des scies de différentes sortes, les ciseaux, les bédanes, les gouges, les serre-joints et les presses, le villebrequin, les mèches, le plomb, le niveau, etc.
Le menuisier doit savoir au besoin faire lui-même tout son outillage.
Mise à jour 2019-01-04
Lettres
Ce dictionnaire en version papier